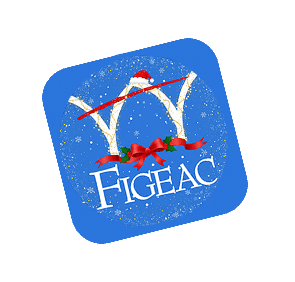Les actualtés du patrimoine
Le 12 mai 1944 : Un jour majeur dans l’histoire de Figeac

Ce jour-là, une part importante de la population de la ville – 450 personnes, pour l’essentiel des hommes entre 16 et 60 ans, mais aussi huit femmes – a été raflée par les nazis et déportée en Allemagne, pour travailler dans des usines ou prisonniers de camps de concentration.
170 de ces Figeacois raflés, dont trois femmes, tous prisonniers politiques, ne reviendront pas.
La rafle du 12 mai 1944 est l’un des faits de guerre les plus graves et les plus traumatisants qu’ait eu à vivre notre cité.
Cet évènement dramatique fut une réponse de l’occupant à l’activité des maquis de l’est du Lot, très forte à partir de la fin de l’année 1943. Persuadés que la population de Figeac soutenait ceux qu’ils qualifiaient de « terroristes », les Allemands, qui multipliaient les arrestations dans la région depuis des mois, voulaient couper les résistants des habitants.
La rafle de Figeac fut le fruit d’une organisation structurée, mise en œuvre par la division SS Das Reich. Alors basée à Montauban, cette unité de soldats nazis avait déjà conduit des actions de terreur envers des civils sur le front de l’est.
Le déroulement de la rafle révèle l’organisation méthodique de la terreur. Une première traversée de Figeac par les nazis dans la nuit du 10 au 11 mai plonge les habitants dans l’inquiétude. Les cibles des Allemands sont alors les maquis de la région. Les exactions et les arrestations seront nombreuses autour du 12 mai dans les villages près de Figeac.
Le soir du 11 mai, les nazis reviennent à Figeac et bloquent les entrées de la ville. Des hommes en arme patrouillent dans les rues. Les SS occupent l’hôtel Tillet, arrêtant propriétaires et employés.
Au matin du 12 mai, tous les Figeacois hommes doivent se rendre à la gendarmerie pour contrôle d’identité. De là, ils sont transférés à l’école des garçons (actuelle école Paul-Bert) où la longue attente, debout dans la cour de l’école, est éprouvante. Quelques hommes sont relâchés, mais la plupart des personnes arrêtées, notamment les hommes entre 16 et 60 ans, sont emmenées par camions à Montauban.
Dans la nuit du 12 au 13 mai, des soldats allemands ivres tirent des coups de feu dans la ville plongée dans la peur et hurlent dans les rues « Figeac terrorist ».
Au matin du 13 mai, après le départ des SS, la ville est sous le choc. Les 450 Figeacois raflés forment la majorité du contingent de 800 Lotois arrêtés par la Das Reich du 11 au 13 mai.
L’épreuve des raflés se poursuit à Montauban. Emprisonnés dans des conditions terribles, ils subissent les interrogatoires des nazis. Certains hommes sont torturés, leurs corps exposés pour terroriser les autres raflés.
Au bout d’une semaine, trois convois quittent Montauban par chemin de fer. Pour les Figeacois prisonniers et déportés, la destination est les usines du Troisième Reich, notamment en Silésie, ou, pour ceux reconnus comme opposants politiques, les camps de concentration de Neuengamme ou Dachau.
Pendant de longs mois, Figeac privée de 30 à 40% de ses hommes survivra dans la stupeur de cette rafle, obligeant des femmes à assurer les besoins de leur famille. Des manifestations de solidarité s’expriment alors entre les habitants.
Le traumatisme est d’autant plus vif que les Allemands reviendront à Figeac et dans la région au mois de juin, pour poursuivre leur lutte contre les maquis et commettre de nouvelles exactions. Le 8 juin, la division Das Reich, en route vers Tulle et Oradour-sur-Glane, conduit le massacre de Gabaudet. Du 20 au 26 juin, les Allemands sont à nouveau présents à Figeac, avant que le débarquement de Provence ne fasse définitivement quitter le Sud-Ouest aux troupes ennemies.
Figeac mettra du temps à penser les blessures d’un évènement qui a profondément marqué ses habitants. Touchés de manière collective et arbitraire, en tant que civils, les Figeacois ont vécu cette épreuve dans une douleur partagée.
Il a fallu attendre le second semestre de 1945 pour voir le retour des raflés. Après la libération et la victoire, Figeac recevra la Croix de Guerre avec médaille de vermeil.
Figeac ne fut pas la seule cible de rafles organisées par la division Das Reich en 1944. Les évènements tragiques de Tulle et Oradour, en juin 44, commis par les mêmes hommes, ont pu faire passer au second plan le drame de Figeac. Mais l’ampleur de l’organisation mise en œuvre par les nazis à Figeac et l’impact durable de cet évènement sur une part importante de la population et la mémoire de ses habitants en fait un jour exceptionnel pour l’histoire de notre ville.
Texte rédigé par Benjamin Philip
Source principale : article de Jean-Pierre Baux,
La rafle du 12 mai 1944 à Figeac (Lot), in revue La Charte n°3, juillet-septembre 2018
Figeac // pays d'art et d'histoire // église Notre-Dame-du-Puy // le retable de Notre-Dame-la-fleurie remis en valeur

Eglise Notre-Dame-du-Puy, Le retable de Notre-Dame-la-Fleurie remis en valeur
Dans le cadre de sa politique de restauration du patrimoine mobilier, la Ville de Figeac a conduit la restauration du retable de Notre-Dame-la-Fleurie, à l’église Notre-Dame-du-Puy. Cette intervention assurée par l’entreprise Malbrel a été soutenue financièrement par le Département du Lot. Une opération de conservation et de mise en valeur qui est l’occasion de remettre en lumière l’histoire d’une dévotion populaire remontant aux origines de la ville.
UNE PIÈCE D’ORFÈVRERIE DATANT VRAISEMBLABLEMENT DU XVIIIe SIÈCLE
Le reliquaire de saint Eutrope est un petit reliquaire monstrance ; son style et les éléments qui le constituent incitent à le dater du XVIIIᵉ ou du début du XIXᵉ siècle. Haut de 30 cm, réalisé en cuivre argenté, il adopte une forme cylindrique et présente trois fenêtres d’ostension vitrées donnant à voir des reliques osseuses.
Le décor orfévré du reliquaire s’inscrit dans les productions du XVIIIᵉ siècle. Son pied circulaire, en particulier, est orné d’une frise de denticules feuillagées ajourées et de motifs inspirés des trophées d’abondance, mêlant des bouquets floraux et des nœuds de draperie. Cette ornementation se retrouve sur le nœud de la tige du reliquaire et un décor comparable, des bandes feuillagées à quatre-feuilles, orne son cylindre.
L’ensemble de l’œuvre présente donc un style artistique homogène, caractéristique du XVIIIᵉ siècle et à rapprocher de l’esthétique baroque. Du XVIIIᵉ siècle également pourraient dater des fragments de textile en soie et fils d’or enchâssant des fragments osseux des reliques.
UN TÉMOIN IMPORTANT DES DÉVOTIONS POPULAIRES FIGEACOISES
La nef de l’église Notre-Dame-du-Puy, à Figeac, abrite côté nord un important retable du milieu du XIXᵉ siècle où se détache une statue habillée de la Vierge à l’Enfant. Cet ensemble architectural et sculpté réalisé en bois, d’inspiration baroque, manifeste la tradition des dévotions mariales qui semble s’être exprimée dans ces lieux depuis le haut Moyen Âge.
Les dévotions à Notre-Dame-la-Fleurie trouvent leurs origines dans un récit miraculeux rattaché à la naissance de la ville : le fleurissement en plein hiver d’un buisson d’aubépine aurait marqué l’emplacement de la fondation de la cité. La présence humaine dès le haut Moyen Âge sur la colline du Puy étant attestée, il n’est pas incongru de penser qu’un lieu de culte dédié à la Vierge ait pu exister en ces lieux très tôt dans l’histoire de Figeac. Des pèlerinages locaux auraient contribué à la christianisation de la région et aux liens de la population rurale à la ville. Les dévotions rendues à la statue de Notre-Dame-la-Fleurie, dans la tradition des Vierges habillées de l’Église catholique, apparaissent jusqu’au début du XXᵉ siècle comme l’un des pèlerinages marials institués dans le Lot.
Le retable conservé mêle une statue de la Vierge à l’Enfant du XVIIᵉ siècle, vestige des dévotions antérieures à la Révolution, à une structure architecturale et des décors du milieu du XIXᵉ siècle.


La statue de la Vierge à l’Enfant s’inscrit dans la tradition des créations populaires de l’époque de la Réforme catholique. Le retable en tant que tel est marqué par un esprit baroque. Sa composition architecturale mêle un autel aux lignes rigoureuses à un baldaquin reposant sur des colonnes élancées.
Le couronnement du baldaquin est composé de volutes, dont le lien avec l’art baroque ne doit pas surprendre. Au XIXᵉ siècle, l’influence du baroque est encore sensible dans les créations religieuses figeacoises destinées à remeubler les lieux de culte endommagés lors de la Révolution. La sobriété marque néanmoins l’ensemble du retable, où dominent les teintes grises. Les couleurs jaune et dorée sont réservées aux panneaux moulurés et aux éléments décoratifs en relief.
La statue de la Vierge à l’Enfant est entourée de représentations de saints dont certains sont caractéristiques des dévotions populaires du XIXᵉ siècle (sainte Germaine de Pibrac, saint Jean l’Évangéliste). Deux anges céroféraires ont été dotés d’une alimentation électrique.
Des symboles de dévotions populaires (Cœurs de Marie) parsèment le retable, tout comme des ex-voto témoins de l’attachement des Figeacois à ce lieu de culte.
REMETTRE EN VALEUR UN ENSEMBLE PATRIMONIAL DÉLAISSÉ ET PERMETTRE SA CONSERVATION
Le retable de Notre-Dame-la-Fleurie n’avait plus fait l’objet de travaux de restauration ou d’entretien conséquents depuis plusieurs décennies.
L’enjeu de l’intervention qui vient de s’achever visait à restaurer son dernier état connu, datant du milieu du XIXᵉ siècle. L’ensemble du retable a été nettoyé et a reçu un traitement insecticide et fongicide. Des lacunes et des décollements ponctuels de décors peints ont été traités. La structure architecturale du retable a été stabilisée et renforcée, par la consolidation des bois en place, leur remplacement ou la pose de greffes. Des textiles utilisés en fond de niches de statues ont été remplacés. Des éléments ornementaux manquants ont été restitués, comme des Cœurs de Marie en applique sur l’autel ou des ex-voto métalliques suspendus au baldaquin. Des installations électriques vétustes ont été retirées et la statue de la Vierge à l’Enfant a été sécurisée. Enfin, une inscription commémorative, panneau de bois peint surmontant le retable au niveau des fenêtres hautes de la nef, a été remise en place.
Si l’aspect général du retable est similaire à celui de son état avant restauration, correspondant- à son réaménagement dans les années 1850-1860, cet ensemble a néanmoins retrouvé une cohérence et une intégrité esthétiques et historiques.
Engagée fin 2020, la restauration du retable de Notre-Dame-la-Fleurie s’est achevée en février 2022.
UN PATRIMOINE NON PROTÉGÉ DONT LA PRÉSERVATION BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DU DÉPARTEMENT DU LOT
Malgré son intérêt historique, le retable de Notre-Dame-la-Fleurie n’est pas protégé Monument historique. Sa restauration a néanmoins bénéficié de la participation financière du Département du Lot, sur son fonds de soutien au patrimoine remarquable. Le conservateur des antiquités et objets d’art du Lot a rédigé le cahier des charges de cette restauration, accompagné la commune de Figeac dans la sélection de l’entreprise en charge de la restauration et suivi les travaux.
Les travaux ont été conduits dans leur intégralité par l’entreprise Malbrel Conservation, établie à Capdenac-le-Haut (Lot).
Figeac cœur d'un pays d'art et d'histoire - Restauration des œuvres d'art - église Saint-Sauveur
Figeac – Abbatiale Saint-Sauveur la commune restaure un tableau du début du XIXe siècle, œuvre d’un architecte de la ville

Poursuivant sa politique de restauration des œuvres d’art propriétés de la commune, la Ville de Figeac a initié en 2021 la restauration d’un tableau religieux du début du XIXᵉ siècle, conservé dans le déambulatoire de l’abbatiale Saint-Sauveur. Une restauration spectaculaire pour l’oeuvre d’un architecte et peintre actif à Figeac sous la Restauration et la monarchie de Juillet.
UN TABLEAU RELIGIEUX PEINT PAR UN ARCHITECTE ACTIF À FIGEAC DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE
Depuis quelques jours, le déambulatoire de l’abbatiale Saint-Sauveur, à Figeac, a retrouvé après plusieurs mois de restauration l’une de ses oeuvres d’art historiques. Un tableau de grand format à sujet religieux, représentant saint Crépin et saint Crépinien, orne à nouveau l’élévation extérieure du rond-point du choeur. Cette toile peinte a été réalisée en 1829 par Joseph Engel, comme en témoigne la signature datée, située dans l’angle inférieur, à gauche du tableau.
Le nom de cet artiste n’est pas inconnu aux amateurs de l’histoire et du patrimoine de Figeac. Originaire de Vienne, Joseph Engel (1784-1836) fut à Figeac dans la première moitié du XIXᵉ siècle un architecte reconnu. Ancien capitaine du génie, il fut pendant la Restauration et la monarchie de Juillet l’architecte de la ville et professeur de dessin au collège. Ce talent de dessinateur explique vraisemblablement cette double activité d’architecte et de peintre.
En tant qu’architecte, Joseph Engel a notamment contribué à la transformation du portail ouest de Saint-Sauveur (il a rédigé en 1819 un rapport préconisant de fait la destruction du porche roman de l’abbatiale). Il a également collaboré à la construction en 1836 de l’obélisque dédié à Jean-François Champollion place de la Raison. Comme peintre, il est aussi l’auteur d’un grand tableau représentant l’adoration du Saint-Sacrement et de l’Agnus Dei, conservé dans le déambulatoire de l’église Notre-Dame-du-Puy.
DES SAINTS MARTYRS POPULAIRES, PATRONS DES CORDONNIERS
Le tableau de l’abbatiale Saint-Sauveur se distingue notamment par son sujet, peu fréquent dans les dévotions traditionnelles de la ville. Il représente deux saints martyrs des premiers siècles du christianisme, saint Crépin et saint Crépinien, originaires de Rome et exerçant le métier de cordonnier. Les récits de leur vie indiquent qu’ils vivaient, en Gaule, dans la région de Soissons et qu’ils moururent martyrisés autour de 285, dans le contexte des persécutions lancées par les empereurs Dioclétien et Maximien. Leur activité de cordonniers fait d’eux les saints patrons de ces artisans et des figures religieuses populaires, vénérées notamment en France et en Grande-Bretagne.
UNE ICONOGRAPHIE RELIGIEUSE TRADITIONNELLE, MARQUÉE PAR L’INFLUENCE BAROQUE
Le grand tableau de Joseph Engel respecte une composition traditionnelle de la peinture religieuse, marquée par des influences remontant aux XVIIᵉ et XVIIIe siècles. Saint Crépin et saint Crépinien portent un costume militaire inspiré de la Rome antique dont les caractéristiques sont héritées du classicisme. Distinguant nettement l’univers céleste du monde terrestre, le tableau représente les deux saints le regard élevé vers des angelots portant un phylactère à leur gloire et s’apprêtant à les couronner. Outre la palme du martyre, les deux hommes arborent la Croix et les Saintes Écritures, qu’ils lèvent au ciel pour souligner un lien au monde divin. Au centre de la toile, la colombe de l’Esprit Saint illumine toute la scène. À gauche, un autel antique de plein air présente les instruments du martyre des deux saints soissonnais et une chaussure, symbole de leur patronage. L’arrière-plan du tableau compose un paysage de collines arborées, dont l’une est couronnée d’un château fortifié.


UNE RESTAURATION CONSÉQUENTE POUR UNE OEUVRE TRÈS DÉGRADÉE
Avant sa restauration, l’oeuvre présentait un mauvais état de conservation, notamment deux importantes lacunes en partie basse.
La restauration du tableau a permis son décrassage, l’allègement de ses vernis, ainsi que le refixage de sa couche picturale. La toile d’origine, très fragilisée, a été doublée et retendue. Son châssis a été remplacé. Les lacunes ont été traitées par des réintégrations illusionnistes redonnant sa cohérence et sa lisibilité au tableau.
La restauration du cadre a vu son nettoyage, sa consolidation et la reprise des lacunes, tant sur les apprêts, que la polychromie ou la dorure à la feuille d’or.
Ces travaux de restauration ont été conduits en atelier par l’entreprise Malbrel Conservation, établie à Capdenac-le-Haut (Lot).